• L'œuvre au noir de David Goodis

Au sein de ce qui devait devenir le roman dit "de série noire", s'esquisse une bifurcation imprévue, dont on peine encore aujourd'hui à mesurer l'importance. Révolution principalement portée par deux plumes véloces : David Goodis et Jim Thompson. Dont l'écho ne se fit entendre que des décennies plus tard, tout autant dans la littérature de genre (Harry Crews, James Crumley, la trilogie noire de Léo Malet entre autres) que dans celle avec un grand L (des auteurs aussi divers que Richard Ford, Jim Harrison, Philippe Djian ou Vincent Ravalec). Pousser l'intensité, la densité à fond, non tant dans l'action que dans l'ambiance, noire et serrée de préférence. Et surtout abolir les derniers garde-fous, les ultimes points de repère qui relieraient encore la série noire au polar classique.
Progressivement ou de manière brutale, selon les livres. L'intrigue est resserrée sur son axe minimum, au plus près des personnages, pour la plupart des "perdants" du grand rêve américain. La toile de fond policière devient de plus en plus grisée, voire même disparait totalement du décor. Le climat général est sombre, mais d'un bouleversant et fabuleux éclat.

Le roman noir, tel que le conçoivent ces deux incontestables génies, cogne dur, rapide et profond. La poésie glaciale de l'envers du décor. Le blues de tous ceux qui trébuchent et ne se relèvent pas toujours. Une visite guidée en enfer qui vous laisse estomaqué. Au jeu du dépouillement, tel qu'il ne laisse plus que l'os, Goodis atteint de tels sommets que son écriture en devient quelquefois inconfortable, tant elle parvient à nous faire vivre au cœur de l'inacceptable. Pire encore : à nous y faire sentir sinon bien, du moins à nous y tenir et mouvoir sans peine. La vision de Goodis est en ce sens plus radicale, plus sereinement désespérée encore que celle de Jim Thompson. Pour l'auteur de "1275 âmes" la rupture, la descente vers les abîmes ne surgit qu'une fois parvenu au bout du rouleau. Pour Goodis, il semblerait qu'elle soit simplement une autre manière de penser, une géographie souterraine, pervertie certes, mais praticable. Ses personnages y trouvent une sorte de refuge, de point de repère.
Récit à fleur de peau qui vous déchire le cœur sans pathos, avec une simplicité de moyens que n'atteindra, pour un résultat aussi bouleversant, que près de deux décennies plus tard "Last exit to Brooklyn" de Hubert Selby Jr, "Sans espoir de retour", autrefois porté à l'écran par le grand Samuel Fuller, illustre à merveille les paradigmes goodisiens.
"Ils étaient, tous les trois, assis sur le trottoir, adossés au mur de l'asile de nuit, serrés les uns contre les autres, pour se protéger du froid mordant de la nuit de novembre. Venue du fleuve, la bise humide qui balayait la rue leur lacérait la figure et les pénétrait jusqu'à la moelle, mais ils ne semblaient pas s'en soucier.
Ils débattaient un problème sans aucun rapport avec la température. C'était une question sérieuse et, dans la discussion, leurs regards se faisaient graves et calculateurs.
Ils se creusaient la cervelle pour trouver un moyen de se procurer de l'alcool".

Nous sommes quelque part entre Bukowski et "En attendant Godot" ("Sans espoir de retour" anticipe d'ailleurs l'un et l'autre). Excepté qu'ici, on n'attend plus rien ni personne. On ne fait pas même semblant, tant le souci d'apparence morale et esthétique est depuis longtemps dépassé, laminé, réduit en morceaux. De même que celui de l'identité, pour tout le moins en surface. Car à l'intérieur ça continue à creuser.
Dans ce trio de damnés de la terre, d'hommes brisés ou pour le dire plus crûment de clochards doublés d'ivrognes, nous suivons la route de Whitey, qui brièvement diverge de celle de ses compagnons d'infortune. La voix éraillée, limite inaudible pour ceux qui manquent d'habitude, les cheveux prématurément blanchis, la plupart du temps ailleurs, dans une léthargie que ne secoue que le feu de la gnôle. Tel est le personnage, en état d'apesanteur, d'anesthésie générale que nous décrit David Goodis. Si proche du KO total d'une mort cérébrale programmée qu'il semble peu probable que quoi que ce fût perturbe le cours de son histoire. Un individu venu du fin fond de son énigmatique passé va secouer cette inertie tout à la fois sordide et bienheureuse. Le suivre, c'est déjà rompre son serment d'immobilité. Et accessoirement franchir les limites de l'Enfer, haute zone de turbulences.
Au fil de ses pérégrinations, le lecteur apprendra par bribes le secret de sa déchéance. Au passage, nous assisterons à des scènes monstrueuses et anthologiques. Un commissariat où le passage à tabac semble être devenu règle d'or, qui apparaît sorti tout droit d'un tableau de Jérôme Bosch. Difficile d'oublier Bertha, terrible femme-bourreau (au sens physique du terme) dont les mains telles des massues prennent plaisir à rabaisser l'orgueil viril. Et si la fin laisse sans voix, ce n'est pas tant qu'elle franchit un degré de plus dans l'horreur, le sordide ou la violence, non parce qu'elle demeure fidèle à ce qu'annonce le titre. Mais à l'inverse, en raison de sa bouleversante douceur. L'atroce est devenu notre "home sweet home", le seul lieu où nous trouvions encore quelque chaleur.
Étrange vie que celle de Goodis, qu'un raccourci facile tendrait à rapprocher de ses œuvres. Son second livre "Cauchemar" est adapté par Delmer Daves, avec en têtes d'affiche Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Rien de moins. "Les passagers de la nuit" se révèle un carton et le romancier devient la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Moins de trois ans plus tard, Goodis rompt les amarres et retourne à Philadelphie, dans la demeure familiale, aux côtés de ses parents et de son frère schizophrène.
Dès lors les conjonctures commencent. S'est-il lassé de ce qu'aucun de ses scénarios n'aboutisse, en dépit d'un contrat renouvelable six ans ? S'est-il vu enfermé dans un succès qui ne lui ressemblait pas ? "Cauchemar" avait été écrit pour un public spécifique et comme acquis d'avance. Plus dure, plus noire semble la vision du romancier. Une hypothèse que vient corroborer le fait qu'une fois de retour au bercail, plutôt que les éditeurs côtés auxquels son talent et sa réputation lui auraient permis de prétendre, il préfère se tourner vers des publications bon marché qui lui laissent toute liberté d'écriture. Les femmes fatales, la violence sont toujours au rendez-vous. S'agit-il en l'occurrence de la part de contrat que doit assurer l'écrivain pour avoir par ailleurs toute licence ? Ou de ses goûts personnels ? Difficile de le savoir. Peu importe en réalité, puisque d'une part Goodis transcende tous les poncifs. De l'autre parce que si tel est le prix à payer pour avoir les coudées franches, l'enjeu en vaut largement la chandelle.

Récits d'une noirceur compacte, dont le héros parfois remonte vers la lumière ("Descente aux enfers"), d'autres non ("Sans espoir de retour"), toujours éminemment poignants et mortellement désespérés, d'une beauté à couper le souffle. Tels sont les paradoxes de l'œuvre goodisienne. Consumé par l'alcool et les démons qui le rongent et dont nous savons en fait peu de choses, David Goodis rendra l'âme à 49 ans. Si ses adaptations cinématographiques par Truffaut ("Tirez sur le pianiste") et Verneuil ("Le casse") ou René Clément (l'étrange et sublime "La course du lièvre à travers les champs") sont à des niveaux différents considérés comme des classiques, c'est surtout le cinéma des années 80 qui fera connaître l'auteur en France, de "La lune dans le caniveau" (Jean-Jacques Beineix) à "Descente aux enfers" (Francis Girod) en passant par "Rue barbare" (Gilles Béhat). Immorale, indécente, mais toujours majestueuse, l'écriture de Goodis n'en a pas fini de fasciner.
Pascal Perrot, texte
Gracia Bejjani-Perrot, graphisme













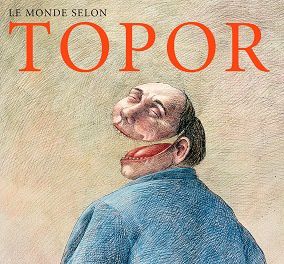



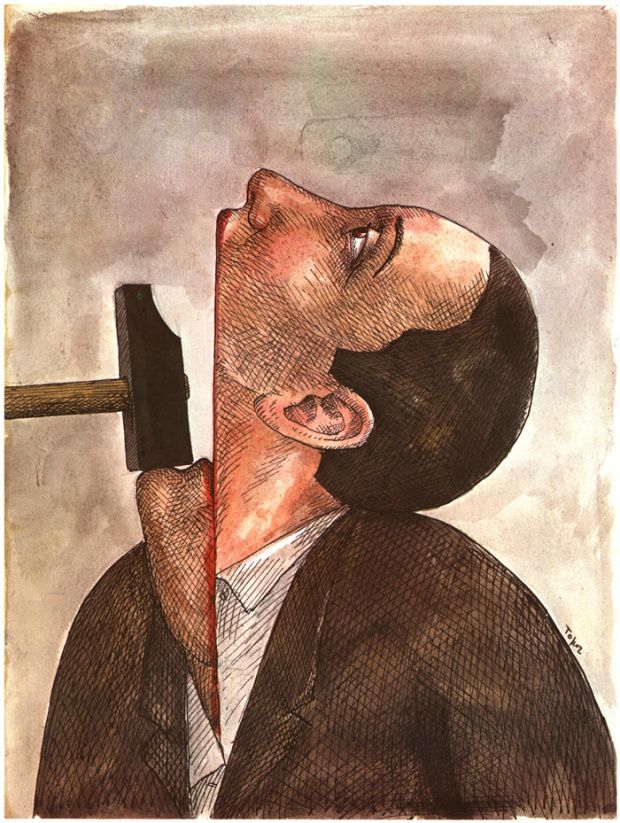


/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_03c1b5_delvaux-6.jpg)
/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_4da84b_delvaux-4.jpg)
/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_8ca1e3_delvaux-3.png)
/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_b00630_paul-delvaux-coiffeur-pour-dames-1933.jpg)
/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_d6a1f5_delvaux-3.jpg)
/image%2F0962499%2F20160911%2Fob_cb39a9_delvaux-1.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_d14f74_87-eme-district-ed-mcbain.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_8160ef_87-e.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_f39744_ed-mc-bain.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_9f3b24_entre-le-ciel-et-l-enfer-2.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_a2edac_soupe-aux-poulets.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_4175e3_liens-de-sang-2.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_df1d98_trintignant-est-steve-carella.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_84218c_livre-bain-1.jpg)
/image%2F0962499%2F20160501%2Fob_19ee82_220px-evanhunter.jpg)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_dc7170_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-18.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_eafd38_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-17.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_f4668e_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-17.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_08f4a2_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-17.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_7c3ec0_avt2-orlando-de-rudder-8329.gif)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_b5a6eb_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-17.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_45d9c6_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-18.png)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_929932_sce-ne-de-me-nage.jpg)
/image%2F0962499%2F20151128%2Fob_d07538_capture-d-e-cran-2015-11-28-a-18.png)

 A moins d'un mois de distance, deux astres de la galaxie du neuvième art se sont éteints. Didier Comès, le créateur de "Silence" et de 'La Belette". Et Fred, l'homme qui inventa "Philémon" et "Le Petit Cirque".
A moins d'un mois de distance, deux astres de la galaxie du neuvième art se sont éteints. Didier Comès, le créateur de "Silence" et de 'La Belette". Et Fred, l'homme qui inventa "Philémon" et "Le Petit Cirque".
 quelconque rétrospective. Ses films n'ont pas tous eu l'honneur d'une édition DVD. Mauvais genre, parce qu'œuvrant dans le comique. Infréquentable, parce que classé à tort aux côtés d'un Zidi première manière (celui qui lança Les Charlots) et un Philippe Clair (immortel auteur de films de bidasse et autres "Plus beau que moi tu meurs"). Un malentendu que l'auteur a contribué à installer, en donnant à "Et la tendresse ? bordel !" et "P.R.O.F.S." (deux grands succès publics au cœur d'une série d'échecs commerciaux) l'apparence extérieure de comédies franchouillardes. Qu'il pervertit de l'intérieur, en en détournant les codes.
quelconque rétrospective. Ses films n'ont pas tous eu l'honneur d'une édition DVD. Mauvais genre, parce qu'œuvrant dans le comique. Infréquentable, parce que classé à tort aux côtés d'un Zidi première manière (celui qui lança Les Charlots) et un Philippe Clair (immortel auteur de films de bidasse et autres "Plus beau que moi tu meurs"). Un malentendu que l'auteur a contribué à installer, en donnant à "Et la tendresse ? bordel !" et "P.R.O.F.S." (deux grands succès publics au cœur d'une série d'échecs commerciaux) l'apparence extérieure de comédies franchouillardes. Qu'il pervertit de l'intérieur, en en détournant les codes.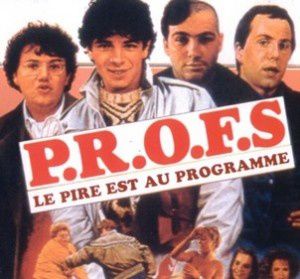 Schulmann est un précurseur, coincé entre deux époques. Il surgit en fin de règne de la comédie franchouillarde, mais bien avant les Inconnus, les Nuls, la Génération Canal Plus. Car c'est à cette famille-là qu'il appartient. Certes, les transfuges du café-théâtre auront débarqué entre temps et progressivement chassé les grands anciens. Mais le style Schulmann, dépouillé de ses alibis vaudevillesques classiques, mettra encore dix ans avant de faire des petits. Car le cinéaste, à mon sens, n'est rien d'autre que l'enfant caché de Mocky et des Monty Python. Un anarchiste acerbe et jovial, qui ne recule devant rien. Ni le mauvais goût, ni l'humour noir, ni le politiquement incorrect. Ni l'absurde, ni le non-sens. Y compris dans ses films les plus commerciaux, "P.R.O.F.S." et "Et la tendresse ? bordel !"
Schulmann est un précurseur, coincé entre deux époques. Il surgit en fin de règne de la comédie franchouillarde, mais bien avant les Inconnus, les Nuls, la Génération Canal Plus. Car c'est à cette famille-là qu'il appartient. Certes, les transfuges du café-théâtre auront débarqué entre temps et progressivement chassé les grands anciens. Mais le style Schulmann, dépouillé de ses alibis vaudevillesques classiques, mettra encore dix ans avant de faire des petits. Car le cinéaste, à mon sens, n'est rien d'autre que l'enfant caché de Mocky et des Monty Python. Un anarchiste acerbe et jovial, qui ne recule devant rien. Ni le mauvais goût, ni l'humour noir, ni le politiquement incorrect. Ni l'absurde, ni le non-sens. Y compris dans ses films les plus commerciaux, "P.R.O.F.S." et "Et la tendresse ? bordel !" Un tel éloge pourrait surprendre ceux qui n'ont de ses films qu'un souvenir confus. Pourtant, les exemples sont légion de cet humour décalé. Dans "Et la tendresse ? bordel !", cette grand-mère rangée dans le placard en même temps que son fauteuil roulant, ou ce caresseur qui affole l'opinion alors qu'il se contente de caresser la tête des personnes qu'il croise. Ce dialogue doux-amer d'un jeune couple ; elle affirme que la beauté physique n'a pas vraiment d'importance. L'homme lui rappelle comment ils ont hérité de leur animal familier : une portée de chats allait être noyée dans une bassine, elle en retire un chaton en protestant "pas celui-là, il est trop beau". Dans ce film, la plupart des histoires d'amour mènent à des impasses. Le jeune romantique finit en macho pressé. Le macho d'origine, joué par Jean-Luc Bideau, dès qu'on lui parle d'une catégorie de femmes, en envisage les possibilités sexuelles. "Je me taperai bien une chinoise, ça doit être pas mal une chinoise"..."Je me taperai bien une secrétaire, ça doit pas être mal une secrétaire". Et finissant castré, affirme "Je me taperai bien une camomille, ça doit pas être mal une camomille".
Un tel éloge pourrait surprendre ceux qui n'ont de ses films qu'un souvenir confus. Pourtant, les exemples sont légion de cet humour décalé. Dans "Et la tendresse ? bordel !", cette grand-mère rangée dans le placard en même temps que son fauteuil roulant, ou ce caresseur qui affole l'opinion alors qu'il se contente de caresser la tête des personnes qu'il croise. Ce dialogue doux-amer d'un jeune couple ; elle affirme que la beauté physique n'a pas vraiment d'importance. L'homme lui rappelle comment ils ont hérité de leur animal familier : une portée de chats allait être noyée dans une bassine, elle en retire un chaton en protestant "pas celui-là, il est trop beau". Dans ce film, la plupart des histoires d'amour mènent à des impasses. Le jeune romantique finit en macho pressé. Le macho d'origine, joué par Jean-Luc Bideau, dès qu'on lui parle d'une catégorie de femmes, en envisage les possibilités sexuelles. "Je me taperai bien une chinoise, ça doit être pas mal une chinoise"..."Je me taperai bien une secrétaire, ça doit pas être mal une secrétaire". Et finissant castré, affirme "Je me taperai bien une camomille, ça doit pas être mal une camomille".

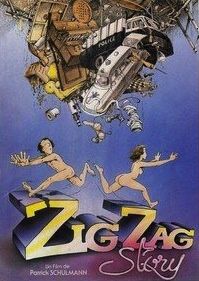 Puis il y aura "Zig zag story", abusivement retitré en vidéo "Et la tendresse bordel 2". Une inventivité visuelle permanente qui rend le film irrésumable. Une histoire d'amour décalée sur laquelle vient se greffer une histoire policière. Tout commence par un embouteillage. Le héros de l'histoire va voir la propriétaire de la voiture qui le devance : "Votre voiture fume … Mais vous fumez aussi, ajoute-t-il en la voyant une cigarette à la bouche." Puis de lui proposer de jouer aux échecs sur un échiquier dont les pièces sont en chocolat (noir et blanc), chaque pièce gagnée étant mangée.
Puis il y aura "Zig zag story", abusivement retitré en vidéo "Et la tendresse bordel 2". Une inventivité visuelle permanente qui rend le film irrésumable. Une histoire d'amour décalée sur laquelle vient se greffer une histoire policière. Tout commence par un embouteillage. Le héros de l'histoire va voir la propriétaire de la voiture qui le devance : "Votre voiture fume … Mais vous fumez aussi, ajoute-t-il en la voyant une cigarette à la bouche." Puis de lui proposer de jouer aux échecs sur un échiquier dont les pièces sont en chocolat (noir et blanc), chaque pièce gagnée étant mangée.
 Avec son opus suivant, Patrick Schulmann retourne définitivement à la case "cinéaste maudit", ne jouissant même pas de la reconnaissance de ses frères en underground. Un sérial killer qui signe ses crimes en glissant les oreilles coupées de ses victimes entre leurs dents ; un criminologue imbu de ses certitudes qui commettra bourde sur bourde en tentant de résoudre l'affaire… tels sont les éléments de départ de "Les oreilles entre les dents". Ensuite, ça devient touffu et foutraque, bourré d'humour noir et absurde jusqu'à la gueule, avec une pléiade de personnages décalés. Bref du Schulmann à l'état pur.
Avec son opus suivant, Patrick Schulmann retourne définitivement à la case "cinéaste maudit", ne jouissant même pas de la reconnaissance de ses frères en underground. Un sérial killer qui signe ses crimes en glissant les oreilles coupées de ses victimes entre leurs dents ; un criminologue imbu de ses certitudes qui commettra bourde sur bourde en tentant de résoudre l'affaire… tels sont les éléments de départ de "Les oreilles entre les dents". Ensuite, ça devient touffu et foutraque, bourré d'humour noir et absurde jusqu'à la gueule, avec une pléiade de personnages décalés. Bref du Schulmann à l'état pur. "Comme une bête" (ah … Schulmann et ses titres !) est un film fou, qui mêle avec maestria toutes les formes d"humour, du paillard au plus subtil. Comme beaucoup de films de Schulmann, c'est une œuvre qui va vite. On ne s'attarde jamais sur une idée plus de quelques minutes, si bien que le réalisateur surfe entre les étiquettes. Tel gag vous semble lourd ? Le suivant vous cueillera par surprise. "Comme une bête" est l'histoire improbable d'un candide qui revient à la civilisation après avoir vécu toute sa vie dans une tribu amazonienne. Il trouve l'amour en la personne d'une jeune femme en surcharge pondérale et possédant une voix d'ange. Sa diva bien-aimée le quitte quand elle perd une trentaine de kilos suite à un tour de passe-passe cinématographique…
"Comme une bête" (ah … Schulmann et ses titres !) est un film fou, qui mêle avec maestria toutes les formes d"humour, du paillard au plus subtil. Comme beaucoup de films de Schulmann, c'est une œuvre qui va vite. On ne s'attarde jamais sur une idée plus de quelques minutes, si bien que le réalisateur surfe entre les étiquettes. Tel gag vous semble lourd ? Le suivant vous cueillera par surprise. "Comme une bête" est l'histoire improbable d'un candide qui revient à la civilisation après avoir vécu toute sa vie dans une tribu amazonienne. Il trouve l'amour en la personne d'une jeune femme en surcharge pondérale et possédant une voix d'ange. Sa diva bien-aimée le quitte quand elle perd une trentaine de kilos suite à un tour de passe-passe cinématographique…